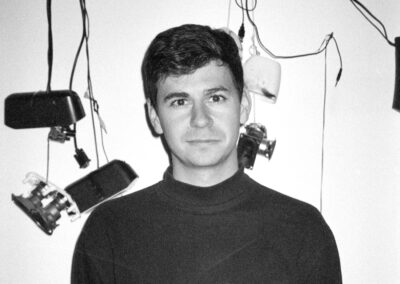FANTÔMES DANS LE PIANO
L’effet larsen
comme partenaire musical
Tom Gurin, Can you see me
Expérimentations : janvier-avril 2025
Enregistrement : mai 2025
Piano, Colin Toniello et Johann Vacher
Composition et régie son, Tom Gurin
Johann Vacher, Ghosts in the Piano, Improvisation n°1
Improvisation utilisant le set-up imaginé par Tom Gurin
Enregistrement : mai 2025
Improvisation au piano, Johann Vacher
Régie son, Tom Gurin
Tom Gurin, Can you see me
Johann Vacher, Ghosts in the Piano, Improvisation n°1
Au premier semestre 2025, le compositeur américain Tom Gurin a développé un système permettant de générer un effet larsen expressif et dynamique à l’intérieur d’un piano à queue. Le dispositif combine un pick-up de guitare électrique, un amplificateur et un transducteur placé sur la table d’harmonie ou sur le cadre métallique de l’instrument. En collaboration avec le pianiste Colin Toniello, Tom et moi avons mené une série d’expériences qui ont abouti à la création de Can you see me, une œuvre de Tom pour deux interprètes et piano amplifié. Dans cette pièce, les deux interprètes n’utilisent que des techniques étendues — sans jamais jouer une seule note au clavier.
Souhaitant prolonger le concept de Tom, j’ai poursuivi nos explorations à travers une série d’improvisations examinant les interactions possibles entre l’effet larsen et le jeu au clavier. Au fil de ce processus, nous avons compris que le comportement de l’effet larsen — cette entité artificielle qui, comme l’a observé Robert Ashley, est « le seul son intrinsèque à la musique électronique » (Holmes 2008, 185) — résiste au contrôle humain. Son émergence depuis le système d’amplification révèle un monde caché, complexe, éphémère et instable. Nos expériences nous ont conduits à poser la question suivante : de quelles manières l’effet larsen dans un piano à queue peut-il fonctionner comme un agent musical non humain, influençant les processus de composition et d’interprétation ?
Collaborer avec l’écosystème de l’effet larsen produit dans un piano à queue revient à entrer dans une forme de négociation : une pratique compositionnelle fondée sur l’improvisation, qui exige de l’interprète une écoute et une adaptation en temps réel. Tom et moi créons ainsi une musique qui ne peut jamais se reproduire à l’identique, s’évanouissant au moment même où elle se manifeste — une forme de collaboration avec des fantômes.
Le piano, lui aussi, est hanté : par le répertoire écrit pour lui et par les attentes véhiculées par l’instrument. En réduisant le clavier au silence, Tom a transformé le piano en un espace vierge, mettant l’accent sur l’émergence des fantômes artificiels de l’effet larsen. Mes improvisations visent au contraire à relier ces fantômes électroniques aux fantômes de l’histoire du piano : rémanences d’harmonies, souvenirs de gestes compositionnels, traces à peine devinées d’œuvres oubliées. En m’autorisant à prolonger son travail par mes propres improvisations, Tom a également invoqué un dernier fantôme : l’art d’interpréter une œuvre en l’enrichissant par un prélude improvisé, des cadences ou des variations — une pratique disparue qui, peut-être, mérite de revenir hanter l’interprétation de la musique contemporaine.